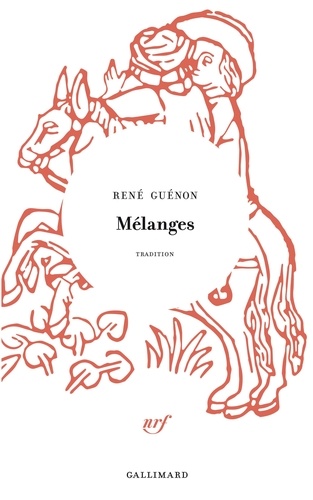.
La civilisation moderne apparaît dans l’histoire comme une véritable anomalie : de toutes celles que nous connaissons, elle est la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel, la seule aussi qui ne s’appuie sur aucun principe d’ordre supérieur. Ce développement matériel qui se poursuit depuis plusieurs siècles déjà, et qui va en s’accélérant de plus en plus, a été accompagné d’une régression intellectuelle qu’il est fort incapable de compenser. Il s’agit en cela, bien entendu, de la véritable et pure intellectualité, que l’on pourrait aussi appeler spiritualité, et nous nous refusons à donner ce nom à ce à quoi les modernes se sont surtout appliqués : la culture des sciences expérimentales, en vue des applications pratiques auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Un seul exemple pourrait permettre de mesurer l’étendue de cette régression : la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin était, dans son temps, un manuel à l’usage des étudiants ; où sont aujourd’hui les étudiants qui seraient capables de l’approfondir et de se l’assimiler ?
La déchéance ne s’est pas produite d’un seul coup ; on pourrait en suivre les étapes à travers toute la philosophie moderne. C’est la perte ou l’oubli de la véritable intellectualité qui a rendu possibles ces deux erreurs qui ne s’opposent qu’en apparence, qui sont en réalité corrélatives et complémentaires : rationalisme et sentimentalisme. Dès lors qu’on niait ou qu’on ignorait toute connaissance purement intellectuelle, comme on l’a fait depuis Descartes, on devait logiquement aboutir, d’une part, au positivisme, à l’agnosticisme et à toutes les aberrations « scientistes », et, d’autre part, à toutes les théories contemporaines qui, ne se contentant pas de ce que la raison peut donner, cherchent autre chose, mais le cherchent du côté du sentiment et de l’instinct, c’est-à-dire au-dessous de la raison et non au-dessus, et en arrivent, avec William James par exemple, à voir dans la subconscience le moyen par lequel l’homme peut entrer en communication avec le Divin. La notion de la vérité, après avoir été rabaissée à n’être plus qu’une simple représentation de la réalité sensible, est finalement identifiée par le pragmatisme à l’utilité, ce qui revient à la supprimer purement et simplement ; en effet, qu’importe la vérité dans un monde dont les aspirations sont uniquement matérielles et sentimentales ?
Il n’est pas possible de développer ici toutes les conséquences d’un semblable état de choses ; bornons-nous à en indiquer quelques-unes, parmi celles qui se rapportent plus particulièrement au point de vue religieux. Et, tout d’abord, il est à noter que le mépris et la répulsion que les autres peuples, les Orientaux surtout, éprouvent à l’égard des Occidentaux, viennent en grande partie de ce que ceux-ci leur apparaissent en général comme des hommes sans tradition, sans religion, ce qui est à leurs yeux une véritable monstruosité. Un Oriental ne peut admettre une organisation sociale qui ne repose pas sur des principes traditionnels ; pour un musulman, par exemple, la législation tout entière n’est qu’une simple dépendance de la religion. Autrefois, il en a été ainsi en Occident également ; que l’on songe à ce que fut la Chrétienté au moyen âge ; mais, aujourd’hui, les rapports sont renversés. En effet, on envisage maintenant la religion comme un simple fait social ; au lieu que l’ordre social tout entier soit rattaché à la religion, celle-ci au contraire, quand on consent encore à lui faire une place, n’est plus regardée que comme l’un quelconque des éléments qui constituent l’ordre social ; et combien de catholiques, hélas ! acceptent cette façon de voir sans la moindre difficulté ! Il est grand temps de réagir contre cette tendance, et, à cet égard, l’affirmation du Règne social du Christ est une manifestation particulièrement opportune ; mais, pour en faire une réalité, c’est toute la mentalité actuelle qu’il faut réformer.
Il ne faut pas se le dissimuler, ceux mêmes qui se croient être sincèrement religieux n’ont, pour la plupart, de la religion qu’une idée fort amoindrie ; elle n’a guère d’influence effective sur leur pensée ni sur leur façon d’agir ; elle est comme séparée de tout le reste de leur existence. Pratiquement, croyants et incroyants se comportent à peu près de la même façon ; pour beaucoup de catholiques, l’affirmation du surnaturel n’a qu’une valeur toute théorique, et ils seraient fort gênés d’avoir à constater un fait miraculeux. C’est là ce qu’on pourrait appeler un matérialisme pratique, un matérialisme du fait ; n’est-il pas plus dangereux encore que le matérialisme avéré, précisément parce que ceux qu’il atteint n’en ont même pas conscience ?
D’autre part, pour le plus grand nombre, la religion n’est qu’affaire de sentiment, sans aucune portée intellectuelle ; on confond la religion avec une vague religiosité, on la réduit à une morale ; on diminue le plus possible la place de la doctrine, qui est pourtant tout l’essentiel, ce dont tout le reste ne doit être logiquement qu’une conséquence. Sous ce rapport, le protestantisme, qui aboutit à n’être plus qu’un « moralisme » pur et simple, est très représentatif des tendances de l’esprit moderne ; mais on aurait grand tort de croire que le catholicisme lui-même n’est pas affecté par ces mêmes tendances, non dans son principe, certes, mais dans la façon dont il est présenté d’ordinaire : sous prétexte de le rendre acceptable à la mentalité actuelle, on fait les concessions les plus fâcheuses, et on encourage ainsi ce qu’il faudrait au contraire combattre énergiquement. N’insistons pas sur l’aveuglement de ceux qui, sous prétexte de « tolérance », se font les complices inconscients de véritables contrefaçons de la religion, dont ils sont loin de soupçonner l’intention cachée. Signalons seulement en passant, à ce propos, l’abus déplorable qui est fait trop fréquemment du mot même de « religion » : n’emploie-t-on pas à tout instant des expressions comme celles de « religion de la patrie », de « religion de la science », de « religion du devoir » ? Ce ne sont pas là de simples négligences de langage, ce sont des symptômes de la confusion qui est partout dans le monde moderne, car le langage ne fait en somme que représenter fidèlement l’état des esprits ; et de telles expressions sont incompatibles avec le vrai sens religieux.
Mais venons-en à ce qu’il y a de plus essentiel : nous voulons parler de l’affaiblissement de l’enseignement doctrinal, presque entièrement remplacé par de vagues considérations morales et sentimentales, qui plaisent peut-être davantage à certains, mais qui, en même temps, ne peuvent que rebuter et éloigner ceux qui ont des aspirations d’ordre intellectuel, et, malgré tout, il en est encore à notre époque. Ce qui le prouve, c’est que certains, plus nombreux même qu’on ne pourrait le croire, déplorent ce défaut de doctrine ; et nous voyons un signe favorable, en dépit des apparences, dans le fait qu’on paraît, de divers côtés, s’en rendre compte davantage aujourd’hui qu’il y a quelques années. On a certainement tort de prétendre, comme nous l’avons souvent entendu, que personne ne comprendrait un exposé de pure doctrine ; d’abord, pourquoi vouloir toujours se tenir au niveau le plus bas, sous prétexte que c’est celui du plus grand nombre, comme s’il fallait considérer la quantité plutôt que la qualité ? N’est-ce pas là une conséquence de cet esprit démocratique qui est un des aspects caractéristiques de la mentalité moderne ? Et, d’autre part, croit-on que tant de gens seraient réellement incapables de comprendre, si on les avait habitués à un enseignement doctrinal ? Ne faut-il pas penser même que ceux qui ne comprendraient pas tout en retireraient cependant un certain bénéfice peut-être plus grand qu’on ne le suppose ?
Mais ce qui est sans doute l’obstacle le plus grave, c’est cette sorte de défiance que l’on témoigne, dans trop de milieux catholiques, et même ecclésiastiques, à l’égard de l’intellectualité en général ; nous disons le plus grave, parce que c’est une marque d’incompréhension jusque chez ceux-là mêmes à qui incombe la tâche de l’enseignement. Ils ont été touchés par l’esprit moderne au point de ne plus savoir, pas plus que les philosophes auxquels nous faisions allusion tout à l’heure, ce qu’est l’intellectualité vraie, au point de confondre parfois intellectualisme avec rationalisme, faisant ainsi involontairement le jeu des adversaires. Nous pensons précisément que ce qui importe avant tout, c’est de restaurer cette véritable intellectualité, et avec elle le sens de la doctrine et de la tradition ; il est grand temps de montrer qu’il y a dans la religion autre chose qu’une affaire de dévotion sentimentale, autre chose aussi que des préceptes moraux ou des consolations à l’usage des esprits affaiblis par la souffrance, qu’on peut y trouver la « nourriture solide » dont parle saint Paul dans l’Épître aux Hébreux.
Nous savons bien que cela a le tort d’aller contre certaines habitudes prises et dont on s’affranchit difficilement ; et pourtant il ne s’agit pas d’innover, loin de là, il s’agit au contraire de revenir à la tradition dont on s’est écarté, de retrouver ce qu’on a laissé se perdre. Cela ne vaudrait-il pas mieux que de faire à l’esprit moderne les concessions les plus injustifiées, celles par exemple qui se rencontrent dans tant de traités d’apologétique, où l’on s’efforce de concilier le dogme avec tout ce qu’il y a de plus hypothétique et de moins fondé dans la science actuelle, quitte à tout remettre en question chaque fois que ces théories soi-disant scientifiques viennent à être remplacées par d’autres ? Il serait pourtant bien facile de montrer que la religion et la science ne peuvent entrer réellement en conflit, pour la simple raison qu’elles ne se rapportent pas au même domaine. Comment ne voit-on pas le danger qu’il y a à paraître chercher, pour la doctrine qui concerne les vérités immuables et éternelles, un point d’appui dans ce qu’il y a de plus changeant et de plus incertain ? Et que penser de certains théologiens catholiques qui sont affectés de l’esprit « scientiste » au point de se croire obligés de tenir compte, dans une mesure plus ou moins large, des résultats de l’exégèse moderne et de la « critique des textes », alors qu’il serait si aisé, à la condition d’avoir une base doctrinale un peu sûre, d’en faire apparaître l’inanité ? Comment ne s’aperçoit-on pas que la prétendue « science des religions », telle qu’elle est enseignée dans les milieux universitaires, n’a jamais été en réalité autre chose qu’une machine de guerre dirigée contre la religion et, plus généralement, contre tout ce qui peut subsister encore de l’esprit traditionnel, que veulent naturellement détruire ceux qui dirigent le monde moderne dans un sens qui ne peut aboutir qu’à une catastrophe ?
Il y aurait beaucoup à dire sur tout cela, mais nous n’avons voulu qu’indiquer très sommairement quelques-uns des points sur lesquels une réforme serait nécessaire et urgente ; et, pour terminer par une question qui nous intéresse tout spécialement ici, pourquoi rencontre-t-on tant d’hostilité plus ou moins avouée à l’égard du symbolisme ? Assurément, parce qu’il y a là un mode d’expression qui est devenu entièrement étranger à la mentalité moderne, et parce que l’homme est naturellement porté à se méfier de ce qu’il ne comprend pas. Le symbolisme est le moyen le mieux adapté à l’enseignement des vérités d’ordre supérieur, religieuses et métaphysiques, c’est-à-dire de tout ce que repousse ou néglige l’esprit moderne ; il est tout le contraire de ce qui convient au rationalisme, et tous ses adversaires se comportent, certains sans le savoir, en véritables rationalistes. Pour nous, nous pensons que, si le symbolisme est aujourd’hui incompris, c’est une raison de plus pour y insister, en exposant aussi complètement que possible la signification réelle des symboles traditionnels, en leur restituant toute leur portée intellectuelle, au lieu d’en faire simplement le thème de quelques exhortations sentimentales pour lesquelles, du reste, l’usage du symbolisme est chose fort inutile.
Cette réforme de la mentalité moderne, avec tout ce qu’elle implique : restauration de l’intellectualité vraie et de la tradition doctrinale, qui pour nous ne se séparent pas l’une de l’autre, c’est là, certes, une tâche considérable ; mais est-ce une raison pour ne pas l’entreprendre ? Il nous semble, au contraire, qu’une telle tâche constitue un des buts les plus hauts et les plus importants que l’on puisse proposer à l’activité d’une société comme celle du Rayonnement intellectuel du Sacré-Cœur, d’autant plus que tous les efforts accomplis en ce sens seront nécessairement orientés vers le Cœur du Verbe incarné, Soleil spirituel et Centre du Monde, « en lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science », non de cette vaine science profane qui est seule connue de la plupart de nos contemporains, mais de la véritable science sacrée, qui ouvre, à ceux qui l’étudient comme il convient, des horizons insoupçonnés et vraiment illimités.
[Symboles fondamentaux de la Science sacrée, chap. Ier. – Publié dans Regnabit, juin 1926. Texte d’une communication faite par l’auteur à la journée d’étude du 6 mai 1926 organisée par la Société du Rayonnement intellectuel du Sacré-Coeur. Sur cette société, cf. Introduction.]